Jean-Paul Dubois : Kennedy et moi / n’est pas président qui veut.
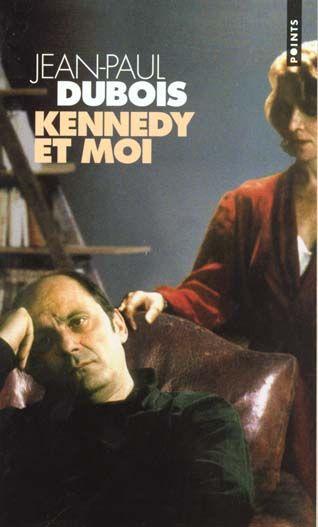
Aujourd’hui, le trouble bipolaire est de mieux en mieux perçu par la société et les tabous commencent à tomber : Catherine Zeta Jones, Loana, témoignent, Jean-Luc Delarue fait de la pédagogie dans un camping-car, Sami Naceri expose ses frasques maniaques dans tous les médias… Bof. Difficile quand même d’adopter le bon ton pour parler d’une maladie assez perturbante et handicapante. Jean-Paul Dubois s’essaye à l’exercice dans un roman : Kennedy et moi, paru en 1996 aux éditions du seuil, roman pour lequel il a obtenu le prix littéraire France télévision la même année.
Samuel Polaris est en pleine dépression. Ecrivain en panne d’inspiration, il vient d’acheter un colt 45. Sa femme, Anna, le trompe avec Janssen, un oto-rhino qui travaille dans le même cabinet qu’elle. Il déteste ses enfants qui n’ont aucun point commun avec lui : ses deux fils se passionnent pour l’informatique, sa fille termine ses études d’orthodontiste. Comment faire pour se sortir de là ? Retrouver le bonheur d’écrire ? La joie de vivre avec une femme ? L’élan vital, tout simplement. Samuel Polaris s’est mis en tête d’acquérir la montre que portait JF Kennedy le jour de sa mort, montre détenue par son psychiatre, Kuriakhine. C’est elle, selon lui, qui pourra le sauver, remettre le temps en marche, la vie en branle. Porter à son poignet la montre du brillantissime Kennedy, c’est actionner à nouveau le tic-tac du succès, de la créativité.
Ecrire un roman sur la maniaco-dépression est à mon sens une gageure que Jean-Paul Dubois a su en partie relever. Difficile, en effet, de passionner le lecteur avec des états d’âme difficiles à cerner, souvent contradictoires et incohérents. Les meilleurs romans que j’ai pu lire sur le sujet adoptaient le ton de l’autodérision, du recul par rapport à la maladie. Jean-Paul Dubois a voulu plonger au cœur de la crise en adoptant un ton sérieux, réaliste. Voilà pourquoi on se trouve souvent devant des pages insipides, ennuyeuses comme la pluie, à l’image du néant qui habite le dépressif. Par ailleurs, Samuel Polaris – décidément un nom prédestiné pour un bipolaire – se trouve confronté à des accès maniaques : il mord son dentiste, il menace son psychiatre avec le colt 45… ces pulsions maniaques ne sont jamais racontées sur le mode de l’humour : il s’agit d’actes désespérés, incohérents, destinés à retrouver une certaine énergie, comme autant de coups de démarreur rageusement infligés à une bagnole en panne.
Cependant, Kennedy et moi dresse aussi le tableau d’une société obnubilée par des choses dérisoires, mesquines, sans intérêt. C’est le regard que porte Samuel Polaris, le dépressif, sur son entourage qui met en relief l’indigence de la vie des gens « sains ». D’abord, il y a l’adultère minable d’Anna avec Janssen : lorsque ce dernier apprendra que Samuel détient un colt, il mettra fin à l’histoire car il craint pour sa petite vie, pour sa famille. Adieu les parties de jambes en l’air avec la belle Anna destinées à combler l’ennui et la misère sexuelle de son petit couple. Comment Samuel, le dépressif, peut-il comprendre que ses fils se passionnent depuis des jours pour une petite formule de JavaScript destinée à animer une page internet de leur site ?
Eh oui, regardons un peu nos vies. Valent-elles la peine qu’on s’y investisse tant ? Aujourd’hui, on se passionne pour un match de foot que tout le monde aura oublié le lendemain, on programme de petits trucs dérisoires qui n’auront d’importance que le temps qu’on leur aura consacré. Et ainsi va la vie. Bien sûr, il y a les plans de carrière : Sarah, la fille de Samuel, y travaille ardemment. Elle construit patiemment une vie qui brillera vraiment le temps d’une microseconde, si elle aboutit dans ses projets… Et puis, comme tout le monde, elle finira par être remplacée par un alter-ego plus brillant, moins usé…
Ainsi, irais-je jusqu’à dire que Kennedy et moi est une sorte d’éloge de la maniaco-dépression qui rend celui qui en souffre plus lucide et plus détaché que les autres des turpitudes et des velléités du monde ? Certes non. Cependant, Jean-Paul Dubois s’est attaché à montrer qu’il y a une normalité dans cette maladie, qu’elle met en relief le monde car elle met en jeu des émotions extrêmes qui agissent comme un prisme nouveau et inconnu sur ce dernier. Par ailleurs, le fait d’avoir choisi un artiste comme héros met en avant l’aspect créatif et imaginatif du maniaco-dépressif lorsqu’il sort des phases de crise. Van Gogh est peut-être celui qui a le mieux su dessiner la « maladie ». Je n’irai pas jusqu’à dire que Jean-Paul Dubois excelle dans l’écriture de ce trouble psychique… mais au moins, il a su le rendre palpable.
A découvrir aussi
- Francis Mizio : Buffet à volonté / lecture à volonté.
- Saphia Azzeddine : Mon père est femme de ménage / petit coup de torchon.
- Jean-Pierre Gattégno : Mortel transfert / Un peu mortel, un peu psychédélique.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres
