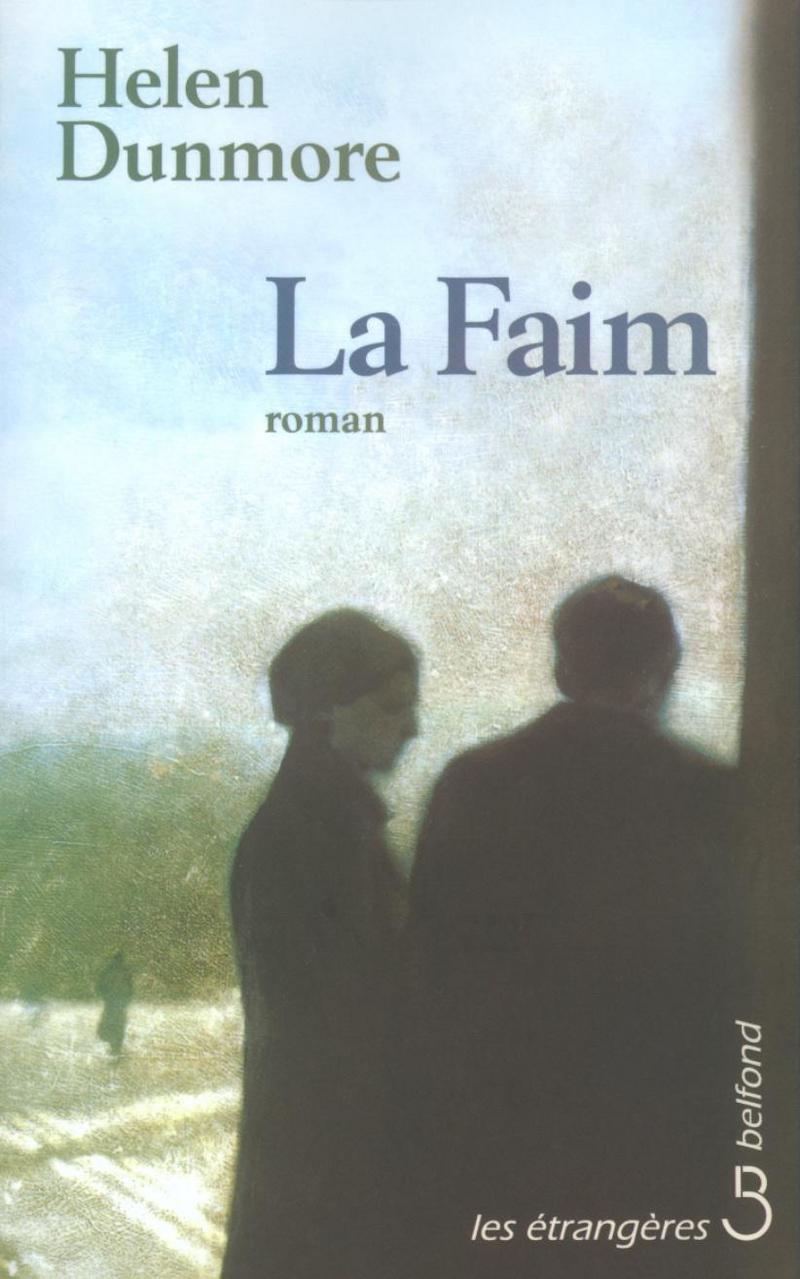Helen Dunmore : La faim / Lecture frugale
Si j’ai horreur de la sensation de lourdeur et de ballonnement qui accompagne les repas trop copieux, je n’aime pas davantage la sensation de faim qui tiraille l’estomac. Je reste donc fidèle à moi-même lorsque je décrète avoir très peu apprécié la faim, roman écrit par Helen Dunmore en 2001 et publié en France en 2003 aux éditions Belfond.
En réalité, le roman ne raconte pas grand-chose. Nous sommes en 1941 et les Allemands font le blocus de Leningrad, réduisant la ville à la famine et à ses conséquences tragiques. Nous suivons Anna, jeune femme résolue et forte, dans son combat quotidien pour sauver sa famille, lui permettre de manger, de se chauffer, car il faut compter avec le terrible hiver russe.
Ainsi donc Anna se retrouve-t-elle à la tête d’une famille qu’il faut nourrir : son père, Mikhaïl, un écrivain en disgrâce, commence à prendre de l’âge et a été blessé lors d’une attaque allemande. Son bras ne guérit pas car la malnutrition ralentit toutes les fonctions corporelles. Et puis, il y a son petit frère, Kolia ; la mère d’Anna est morte en le mettant au monde et depuis, Anna s’occupe de lui comme s’il était son propre fils. Enfin, Marina, une ancienne actrice et maîtresse de Mikhaïl loge aussi auprès de la famille. Anna se débat donc entre les tickets de rationnement, les queues interminables devant des magasins vides, les occasions inespérées d’obtenir un bout de viande ou du sucre. En ces temps de disette, on mange tout et n’importe quoi : le cuir sert à faire du bouillon, et est considéré comme de la viande, le pain est composé principalement de pâte de cellulose, les chiens, les chats, les rats disparaissent mystérieusement de Léningrad, certains cadavres sont démembrés, des enfants disparaissent. Malgré tout, les gens maigrissent, tombent malades, meurent. Marina et Mikhaïl ne survivront pas à la famine. Et puis, il y a le chauffage. Anna réussit à se procurer un poêle au marché noir. Ensuite, c’est toute une épopée pour trouver du bois. Les livres et les meubles sont brûlés et malgré tout, il fait froid dans le petit appartement d’Anna.
Pour mettre un peu de variété dans ces pages extrêmement répétitives et lassantes, Helen Dunmore a introduit un personnage masculin, Andreï, un ami de Mikhaïl, médecin à l’hôpital de Léningrad ; Anna s’entiche de cet homme, cependant, il ne se passe pas grand-chose. La faim réduit les fonctions corporelles et les amoureux ne se touchent pas. Ils sont trop épuisés par la lutte quotidienne pour la survie. Et puis, bien évidemment, il y a le passé ; Anna découvre que Marina fut la maîtresse ponctuelle de Mikhaïl, son père, mais que celle-ci s’est retirée face à l’épouse de ce dernier : un amour principalement platonique, donc, qui ne s’éteindra qu’avec la mort des deux amants, à quelques semaines d’écart…
La faim n’est certainement pas un mauvais roman : il est bien écrit et témoigne des souffrances quotidiennes de la population de Léningrad pendant le blocus de la ville en 1941. La faim ou quand satisfaire ses fonctions vitales devient le but de chaque journée. La répétition des pages évoquant la recherche d’aliments ou de combustibles permet au lecteur de mesurer l’ampleur et la gravité de la situation des habitants de Léningrad : on passe des heures dans les files d’attente, pour pas grand-chose, on économise ses gestes pour ne pas dépenser trop de calories. La faim nous plonge dans l’atrocité de ce quotidien voué à une survie incertaine et douloureuse. Cependant, on finit par s’ennuyer de tant de répétition et on a l’impression de tourner en rond dans ce roman. Sans doute est-ce là une volonté de l’écrivain qui a tenté par là de montrer à quel point on finit par tourner en rond dans une ville sujette au blocus, vide de toute subsistance… Mais peut-être le lecteur a-t-il besoin d’un peu plus de matière narrative pour nourrir son intérêt, car, eh oui, le lecteur crie famine lorsqu’il lit la faim.
En tout cas, ce roman fait vraiment prendre conscience de la chance que la plupart des Français a : manger à sa faim, et même plus, et ce, tous les jours ; se préoccuper comme d’une guigne des repas qu’on n’a même plus besoin de préparer. Et quand on sait qu’en moyenne, un français jette vingt kilos de nourriture par an… et quand on voit à la cantine du lycée des abrutis mettre à la poubelle leur portion de viande intacte sans même tiquer, loin de toute analyse ou critique de la portée de ce geste effectué dans la plus normale des indifférences ! Il y a de quoi vomir. Oui, par moments, la faim, il faudrait encore la ressentir vraiment, là, tenailler le creux de nos estomacs pour prendre la mesure de la valeur de la nourriture.
A découvrir aussi
- Jean-Philippe Toussaint : Faire l’amour/Faire caca.
- Stephen McCauley : sexe et dépendances / aucun risque de dépendance...
- Federico Moccia : J’ai envie de toi/J’ai pas envie de donner envie de lire ce roman.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 44 autres membres